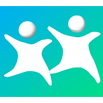« L’humain avant tout »
L’humain avant tout… ou l’inépuisable question du rapport de subjectivité dans un cadre professionnel
« L’humain avant tout ». Ce principe que DirecTransition revendique sur son site résonnera sans doute de façon très différente pour chacun des visiteurs qui nous font le plaisir de nous consacrer quelques instants. Elle réjouira peut être l’adepte de la conception vocationnelle du travail social qui présuppose que la relation d’aide se limite à la capacité d’empathie, voire d’amour de l’autre, elle désolera certainement celui qui pense que comme toute profession, celles du champ social et médicosocial ne reposent que sur un savoir-faire qu’il suffit de mettre en œuvre. Au risque de décevoir l’un et l’autre, nous sommes convaincus qu’il ne s’agit ni de ceci, ni de cela. Ces quelques lignes n’ont pas la prétention d’épuiser la question que de nombreux auteurs ont tenté de cerner avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d’objectivité : « qu’est-ce qui se joue, pour un salarié dont l’acte pour lequel il est rémunéré et professionnellement reconnu, consiste essentiellement ou exclusivement à entretenir une relation supposée aidante ou soignante avec un autre individu ? ». Notre démarche s’attache plutôt à porter un regard sur la façon dont cette question de l’engagement du sujet, c’est-à-dire, au sens premier du terme, de la subjectivité, diffuse dans l’ensemble des dispositifs et concerne l’ensemble des acteurs qui composent l’architecture institutionnelle du champ social et médicosocial, bien au-delà des professionnels éducatifs, pédagogiques ou soignants pour lesquels elle constitue un enjeu évident.
De l’association à l’organisme gestionnaire
C’est sans doute une spécificité française d’avoir confié le déploiement des politiques publiques, en matière d’action sociale et médico-sociale, à des organismes privés associatifs. Certes, depuis de nombreuses années déjà, nous voyons apparaitre des sociétés marchandes dans notre secteur d’activité, mais, à ce jour, elles se limitent à un segment dont la solvabilité est partiellement assurée par le « client » et non pas exclusivement par la solidarité publique. Les EHPAD sont fortement concernés, mais il n’est pas exclu qu’au train où va la mode des « partenariats public/privé », l’ensemble de notre secteur puisse demain être touché par cette évolution. Par ailleurs, il existe déjà certains professionnels du champ social ou éducatif qui interviennent à titre libéral. Ceci est sans doute révélateur d’une évolution des mentalités, des pratiques et, par conséquent, des représentations et des relations entre professionnels et bénéficiaires qui a très profondément modifié le sens de l’action médico-sociale et sa finalité. On en trouve la traduction dans les changements importants des modalités de gouvernance des associations qui interviennent dans notre champ d’activité ainsi que dans les relations qu’elles entretiennent avec leurs partenaires institutionnels. De ce fait, il nous semble nécessaire de nous attacher à la compréhension des mécanismes en jeu au sein de nos institutions et du lien qu’elles entretiennent avec leur environnement. Leurs corollaires sémantiques, également, peuvent aider à comprendre comment nous sommes « pris » dans ces évolutions pour tenter de nous en déprendre
La question de la relation, elle est en effet déterminée dès l’origine par la manière dont les Pouvoirs Publics sollicitent les associations pour la mise en œuvre des politiques publiques. A ce titre, il est intéressant de regarder les mots par lesquels cette complémentarité se désigne. Il y a quelques décennies, nous vivions sous le régime de l’agrément. Outre sa plaisante homonymie, le terme sous-tend une validation qui ne repose pas exclusivement sur des critères techniques ou financiers et suppose une proposition présentée par l’opérateur potentiel que le prescripteur public va agréer ou ne pas agréer. Il y a, dans le terme et dans le processus qu’il désigne, la nécessité d’un échange, d’un dialogue, entre l’opérateur associatif et le responsable de l’organisme public qui va l’autoriser ou non à déployer son action sur le terrain. A cette époque bientôt préhistorique, le temps de l’agrément et le temps du financement étaient clairement distincts. Une association obtenait son agrément pour une durée généralement de plusieurs années et présentait annuellement son budget et son compte de résultat, sur la base desquels le financeur allouait les moyens nécessaires au déploiement de l’action pour un exercice. Cette scansion disait clairement une volonté de distinguer le temps du projet de celui de sa mise en œuvre. Le projet associatif, c’est-à-dire l’intention, les valeurs, les références théoriques, en un mot, (soyons grossiers) l’idéologie du porteur de projet avait toute sa place dans l’interlocution avec les Pouvoirs Publics, qui, à leur tour, n’hésitaient pas à faire en partie reposer leur décision sur la subjectivité des agents qu’ils mandataient dans ces échanges. Ce n’est que dans un second temps que l’on discutait des moyens, et, même s’il est vrai que les contraintes budgétaires sont devenues sensiblement plus drastiques, ce serait une erreur d’accréditer l’idée aujourd’hui répandue que ce fonctionnement poussait au gaspillage et permettait de financer n’importe quoi. Au contraire, il y avait le temps de la réflexion sur la pertinence d’un projet au vu des orientations des politiques publiques et de besoins des bénéficiaires, et, dans un second temps, un arbitrage sur les moyens alloués. Ce mécanisme permettait à chaque partie d’assumer clairement ses responsabilités. L’association était désignée en tant que telle et l’organisme public nommé tutelle. Certes, ce terme n’est pas très heureux, en ce qu’il suppose une autorité omnipotente du donneur d’ordre et une certaine incapacité de l’association mise ainsi sous tutelle, mais il a l’avantage de désigner clairement la nature des responsabilités respectives de chaque acteur. La tutelle ne peut pas, du fait même du mot qui la désigne, décliner sa responsabilité dans la politique publique mise en musique par l’association qu’elle a agréée. Puis est venu le joli temps des conventions. Notamment les conventions tripartites qui président aux destinées des EHPAD. Il y a encore du contenu, dans ce qui fait l’objet d’une convention, mais déjà se confondent dans un même mouvement les objectifs et les moyens et ses signataires ne sont pas clairement définis dans la différence de leurs places. D’ailleurs, dans ce même temps, nous parlions d’opérateurs et de financeurs. Les fonctions ne sont pas les mêmes, certes, mais si le pouvoir est toujours du côté des cordons de la bourse, ces désignations fonctionnelles et opératoires des acteurs commençaient déjà à gommer le rapport d’autorité, donc, de responsabilité qui les lie, à faire disparaitre dans le flou du second plan l’orientation politique qui motive leur action ; à réduire leur interlocution à un dialogue fonctionnel. Aujourd’hui, les associations sont devenues des organismes gestionnaires, les Pouvoirs Publics des autorités de contrôle et de tarification, et, ce qui les lie, des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Plus un signifiant comporte de mots, plus il vise à la précision. On voit bien là une dynamique visant à circonscrire chaque acteur et le contrat qui les lie à une dimension limitée, voire exclusive, qui assigne chacun à une place et une fonction univoque qui rend impossible et de toute façon inutile toute interlocution.
La place de l’humain et l’illusion rationaliste
Si nous avons voulu développer cette évolution sémantique, c’est pour tenter de montrer comment, au niveau même des acteurs institutionnels et de ce qu’ils contractualisent, la question de la relation et de la subjectivité des intervenants est posée. Certes, les organismes publics, les associations et les établissements qui les composent sont constitués d’hommes et de femmes qui continuent à dialoguer et, heureusement, encore souvent de façon sincère et impliquée. Mais le cadre même dans lequel s’inscrit le « dialogue budgétaire » n’incite plus et, parfois même, interdit la relation entre les représentants des différentes composantes du champ médico-social, relation humaine indispensable pour donner corps et sens aux projets mis en œuvre et aux actions qui se déclinent sur le terrain.
Ces évolutions formelles et leur traduction sémantique se sont produites dans un « air du temps » qui, sans doute imprégné des objectifs court-termistes de la financiarisation de la société, oppose, dans une curieuse dialectique au service de « l’efficacité », réflexion et action, pratique et pensée, et dans lequel, de façon tout à fait paradoxale, un discours sur des préoccupations humaines et humanistes autour de la question de la bientraitance a promu des préconisations et des pratiques dont le formalisme tend à exclure la relation et la dimension humaine entre les professionnels des ESMS et leurs bénéficiaires.
De la toute-puissance à l’impuissance du travailleur social
Le champ de l’intervention sociale a fonctionné longtemps sur le principe d’une modalité de prise en charge élaborée par l’équipe de l’établissement prestataire et proposée au bénéficiaire sans qu’il ait réellement une opinion à exprimer sur le service qui lui était apporté. Effet domino, peut-être, d’une représentation descendante de la chaîne de décision qu’illustre le terme de tutelle, cette organisation de l’action sociale n’excluait pas la relation humaine des pratiques éducatives, pédagogiques et thérapeutiques, mais ne facilitait pas son questionnement. Malgré l’existence de longue date du travail d’analyse des pratiques proposé aux équipes, l’absence de prise en compte de la parole du bénéficiaire ne facilitait pas la mise au jour de certaines pratiques inadaptées. Les travailleurs sociaux ont souvent fait preuve d’une certaine résistance à rendre compte de leur action, au prétexte souvent sincère qu’elle repose sur une relation toujours singulière, entre eux et les bénéficiaires, qui relève du registre personnel, voire intime. Cette posture, qui repose à notre avis sur une certaine confusion qui voudrait que le caractère subjectif de cette relation la cantonne nécessairement à la sphère privée, a longtemps fait vivre une forme de « toute-puissance » du professionnel engagé dans la relation d’aide. Il ne faut pas le nier, cette conception de l’action éducative et sociale a sans doute favorisé des situations de maltraitance active et c’est le grand mérite des lois sur les droits des usagers, plus particulièrement la loi 2002-2, de s’être saisies de cette question. Malheureusement, les solutions qu’elles apportent sont parfois pires que le mal à traiter. Sans doute pris lui-même dans l’air du temps rationaliste qui exclut toute subjectivité, le législateur a mis en place une batterie de protocoles formels, qui, s’ils permettent parfois de repérer de réelles situations de maltraitance active ou délibérée, plongent les établissements médico-sociaux dans des processus de fonctionnement où le professionnel est tellement mobilisé par le contrôle et le suivi des aspects formels de ses pratiques, que la question de sa relation aux usagers n’est même plus abordée. Cette mise en équations des relations humaines produit la situation paradoxale de professionnels individuellement bienveillants qui constituent un collectif de travail réellement maltraitant par ses obligations du respect formel de protocoles au détriment de la prise en compte de chaque individualité. Nous en sommes au point que dans certains centres de formation en travail social, le fait d’engager sa subjectivité dans la relation à l’autre est présenté comme une erreur, voire une faute professionnelle… Il y a bien, dans la loi de 2002, quelques initiatives heureuses visant à instaurer quelque chose qui s’élabore réellement au niveau de la relation entre les personnes, notamment la mise en place à plusieurs niveaux d’instances consultatives et participatives, plus particulièrement le Conseil de la Vie Sociale. Mais la charge technique induite par la masse de protocoles à respecter conduit souvent les institutions à peu investir ces espaces où pourraient pourtant s’exprimer les questions relatives à la « vraie vie » des établissements…
Le manque de moyens : paradoxe et cercle vicieux
Ce n’est donc pas la restriction des moyens et des effectifs qui, à elle seule, tend à faire disparaitre de nos institutions la prise en considération de tous les effets d’attachements et d’affectivité entre les acteurs qui y vivent et y travaillent. Bien entendu, la diminution scandaleuse et dramatique des moyens humains, plus particulièrement dans les établissements sanitaires et dans ceux du champ de l’exclusion sociale, est un facteur important de ce processus et s’inscrit pleinement dans le mécanisme que nous avons tenté de décrire. Il convient de noter ici que les taux d’absentéisme et d’accidents du travail dans les EHPAD sont respectivement supérieurs de 30% et de 50% par rapport au reste du secteur sanitaire, lui-même affecté par des taux très sensiblement supérieurs à ceux constatés toutes activités confondues. Il est évident que la surcharge de travail induite par la baisse des effectifs est la première cause de cet état de faits. Mais ce manque de moyens est un élément si central et si massif qu’il conduit souvent les responsables de structures médico-sociales à le considérer comme seule cause des difficultés qu’ils rencontrent, voire des situations de crise, sans prendre conscience qu’il y a souvent, à l’origine de celle-ci, une panne de la relation humaine, sans lien nécessaire avec la question des moyens. Plus grave encore, cette insuffisance d’effectifs conduit presque immanquablement l’encadrement à organiser le travail dans une logique exclusive de gestion de la pénurie qui finit par se traduire par un minutage de chacune des tâches de prise en soin, à l’exclusion de toute prise en compte de l’individualisation des besoins des usagers et des pratiques des salariés. Cette gestion purement technique du temps alimente les effets de rupture du lien et de la dimension relationnelle du travail, car elle se fait évidemment au détriment des séquences jugées « improductives », et c’est ainsi que les réunions d’équipes disparaissent, que le travail d’analyse des pratiques se transforme en lointain souvenir, que les projets individualisés supposés résulter d’un travail interdisciplinaire associant l’usager et sa famille s’écrivent sur un coin de table par l’éducatrice ou le psychologue de service, que les relèves se limitent à une transmission de consignes techniques et que les CVS, lorsqu’ils ont encore lieu, sont très loin de remplir les fonctions d’espaces de concertation et de médiation que la règlementation leur assigne. Il est évidemment tout à fait contre intuitif de considérer que lorsque l’on manque de temps, il est vital de prendre son temps. C’est cependant ce que l’expérience nous enseigne et, si l’on regarde le manque de moyens non pas pour ce qu’il est « techniquement », mais pour ce qu’il révèle, dans toute sa dimension symbolique, de la négation de la question de la place de la relation humaine, alors, oui, il est tout à fait logique d’y résister en réintroduisant dans les institutions que nous dirigeons, non seulement les modalités formelles d’échange et de concertation que constituent les différents types de réunions, mais également les espaces et les temps interstitiels de René ROUSSILLON et les corridors du quotidien de Paul FUSTIER… Sans oublier la machine à café, addiction oblige et pour nous qui travaillons essentiellement dans les espaces du siège, car l’institution étant un tout, il y a souvent incidences réciproques entre la qualité des relations professionnelles au sein des services administratifs et techniques et de celles qui prévalent au sein des équipes interdisciplinaires intervenant auprès des usagers.
La reconnaissance des savoirs
Ces évolutions s’inscrivent dans un paysage au sein duquel résiste une représentation de l’échelle des savoirs. Contrairement aux pays anglo-saxons et nordiques, les pays latins, et plus particulièrement le nôtre, peinent à se départir de l’idée que les filières « générales » sont plus nobles que les filières techniques ou technologiques. Nous ne posons pas la question de savoir si l’école doit permettre la construction d’un citoyen pas trop aliéné ou celle d’un travailleur « bancable » sur le marché de l’emploi. Bien que ce débat soit essentiel, ce n’est pas l’objet qui nous occupe ici. Nous posons celle de savoir la valeur que l’on accorde, pour eux-mêmes, aux différents types de savoirs. Si l’on regarde l’échelle des salaires, il est flagrant que l’on rémunère souvent bien, dans notre pays, le savoir théorique ; qu’il est réservé un sort très disparate au savoir-faire, entre la rémunération d’un ouvrier ou d’un footballeur en passant par celle d’un artisan ; et que l’on rémunère toujours mal le savoir-être. Le scandale absolu, selon nous, concerne la situation des auxiliaires de vie à domicile, amenées (Nous employons le féminin car ce métier est presque exclusivement assuré par des femmes) à intervenir seules auprès de personnes en difficultés, hors du cadre plus ou moins sécurisant des murs de l’institution et sans l’étayage d’une équipe, et qui doivent réaliser des tâches souvent ingrates en déployant des trésors de diplomatie pour convaincre un malade rétif à faire sa toilette ou désarmer le comportement agressif d’un conjoint qui ne sait exprimer qu’ainsi son désarroi face à la souffrance de la personne qu’il aime. Ces personnes, payées au minimum légal, ne voient même pas prises en compte à leur juste mesure les contraintes spécifiques de leur métier, et le temps entre deux interventions ne leur est pratiquement jamais rémunéré au réel de ce qu’elles engagent. Dans nos conventions collectives, la dernière revalorisation du point d’indice remonte parfois à si longtemps que le salaire conventionnel des aides-soignants et des AMP se trouve inférieur au SMIC, de sorte que l’on doit apporter un complément qui permet de verser une rémunération conforme au minimum légal. A-t-on pensé une seconde à la dimension symbolique du message que l’on adresse à une personne dont l’essentiel du travail repose sur la relation qu’elle engage avec un usager qui souffre de sa maladie, de sa dépendance ou de son isolement, lorsque l’on signifie noir sur blanc sur son bulletin de salaire : « votre travail ne mérite pas le SMIC ». Car, au bout du compte, c’est bien cela que signifie cette incapacité à valoriser correctement le travail de ces professionnels de la relation d’aide.
De notre place de directeurs de transition
Il serait, nous pensons, d’une coupable naïveté de ne pas faire la critique politique de ces évolutions, contemporaines de la financiarisation des activités économiques, et, finalement, de l’ensemble des échanges qui traversent et structurent la société toute entière, y compris ceux que nous pouvions penser, il y a quelques années encore, échapper à la sphère économique. Ce regard que nous tentons ici sur le « comment » de ces mutations ne signifie donc pas que l’on doive être dupe de leur « pourquoi ». Il ne fait que traduire une intention, à une place nécessairement opérationnelle et pragmatique de directeur de transition, de ne pas faire précéder nos interventions par nos présupposés idéologiques, quelle qu’en soit leur pertinence, car ce que nous avons à démêler de situations complexes, parfois inextricables, d’établissements qui souffrent et font souffrir par là même leurs salariés et leurs bénéficiaires, leurs « usagers » dit-on aujourd’hui, repose avant tout sur les liens subjectifs entre les humains qui s’y occupent. La question plus objective (ou supposée l’être) de la détermination éventuelle des causes et des responsabilités ne pourra venir qu’après. Il nous faut tout d’abord nous y engager, dans ces institutions, sans bien sûr nous départir de notre lucidité, de nos outils, de notre expérience qui, malgré tout, nous protègent des mécanismes mortifères action/réaction, et pour autant sans illusion sur le fait que toute action et toute décision supposent l’engagement dans une relation avec ces hommes et ces femmes, ne serait-ce que par les conséquences que nos décisions pourront avoir pour eux. Autrement dit, ce type d’intervention mobilise nécessairement notre propre subjectivité. C’est sans doute ce qui différencie le plus fondamentalement une mission de transition et une mission d’audit. Bien que nous produisions, dans la plupart des cas, un rapport de mission faisant diagnostic et préconisations, il ne s’agit pas d’un audit au sens habituel du terme, car notre diagnostic ne résulte pas de la mise en place d’outils d’analyse selon un protocole donné, mais de notre expérience « in vivo » et que nos préconisations s’inscrivent dans la continuité d’actions que nous aurons nécessairement initiées, de notre place de directeur. Comme le fait justement remarquer l’un de nos collègues, nous employons souvent le terme d’« étonnement » à DirecTransition. Cela pourrait au premier abord sembler paradoxal que des directeurs expérimentés, rompus aux situations souvent atypiques que constituent les états de crise que nous avons à gérer, mettent en avant cette capacité d’étonnement qui renvoie plutôt à la fraîcheur du candide qui découvre le monde. C’est que l’étonnement ne se limite pas à un questionnement qui résulterait de l’analyse objective d’une situation non conforme aux usages, aux pratiques habituelles, à la réponse à des besoins justement évalués… Il renvoie à une dimension plus subjective, voire émotionnelle, qui suppose qu’avant de mobiliser notre intelligence formelle et de faire appel à notre savoir-faire et à notre expérience, nous « soyons » à l’institution comme on dit que l’on « est » au monde. Condition probablement nécessaire pour que nos missions ne reposent pas exclusivement sur la mise en œuvre de mesures techniques, mais avant tout sur une série de rencontres à partir desquelles se renouent ou se nouent autrement les relations humaines entre les différents acteurs de l’institution.
« L’humain avant tout », chacun l’aura compris, ce n’est pas un manifeste angélique proféré pour faire croire qu’il suffit de mettre du lien pour que les personnes s’entendent et se comprennent. L’humain, c’est aussi des tensions, du conflit, des incompréhensions, des inimitiés. Mais croire que l’on traitera ces difficultés en cachant leur existence derrière le paravent des procédures, ce n’est que le meilleur moyen de les renforcer et de générer ainsi l’état de crise. Ce que nous voulons dire à travers cette tentative de porter un regard plus distancié sur notre champ de l’action sociale et médico-sociale, ce n’est finalement qu’une évidence : le fonctionnement de tout groupe humain repose avant tout sur les relations des individus qui la composent. Les règles qui le régissent ont pour objet de poser des limites, de définir ce qui est licite ou illicite, mais elles ne peuvent conduire à réduire ces relations à des interactions formatées, minutées et nomenclaturées, au risque que le sujet se rappelle au bon souvenir de la collectivité qui le nie, par la dépression, la transgression ou la folie.
Pierre SALOMON et Nicolas MARTIN
NOS RÉFÉRENCES
Partenaires & entreprises pour lesquels nous avons réalisés des missions de transition.
Pour des raisons de confidentialité, toutes les entreprises ne peuvent être mentionnés